Docu-menteur
The making of Berlin par le collectif BERLIN/Yves Degryse
Si l’utilisation de la vidéo au théâtre n’est pas nouvelle, elle fait depuis au moins une dizaine d’année l’objet d’une expérimentation qui va au-delà de la simple illustration pour en faire l’outil d’une intersection entre pratiques et formats du spectacle vivant, de l’art et du cinéma. Du 1 au 5 mai 2024 au CENTQUATRE-PARIS s’est tenue la reprise du spectacle The making of Berlin du collectif BERLIN, mêlant cinéma documentaire et performance scénique.
Au cours de plusieurs spectacles mêlant documentaire et performance, le collectif flamand BERLIN a fait la démarche dans son cycle Holocène de faire le portrait de villes au travers de portrait de vies individuelles. Lorsque vient le temps pour le collectif de clore le cycle en représentant la ville dont ils ont repris le nom, c’est à la vie de Friedrich Mohr que s’intéresse le metteur en scène Yves Degryse. Régisseur de l’orchestre philharmonique sous l’Allemagne nazie, il aurait été initiateur d’un projet d’envergure démesurée. En 1945, alors que Berlin subissait des bombardements de plus en plus soutenus, il aurait tenté sans succès de faire jouer un épisode du Crépuscule des dieux de Wagner par un orchestre réparti dans sept bunkers et diffusé en direct à la radio.
C’est du rêve de cet homme ambigu et de la volonté d’en recréer les caractéristiques à l’époque contemporaine que naît le projet de spectacle BERLIN, et dont le spectacle serait le making of au travers des images de la réalisatrice Fien Leysen. Au mitan de l’œuvre cependant, une révélation vient ronger de l’intérieur l’entreprise : Friedrich Mohr aurait menti. On ne connaîtra jamais avec certitude l’ampleur de ce mensonge, sinon qu’il enclenche un double renversement dans la nature de l’œuvre qui nous est présentée. Le spectacle est-il le récit de la genèse mouvementée d’un projet, l’investigation d’une imposture ? Ou, perspective plus vertigineuse encore, est-il le manifeste du format exploitant les codes du documentaire pour exposer la fabrique de la fiction ? La découverte lors du générique de fin d’un nom apposé au rôle de Friederich Mohr achève de placer l’œuvre dans son entièreté sous le sceau du doute. Et si le projet lui-même n’était qu’une fiction élaborée ?
Il peut sembler étrange que je n’ai jusqu’ici pas parlé du dispositif scénique. C’est précisément sur ce point que se situent les limites comme les paradoxes de la pièce. S’il y a en effet une dimension scénique, elle est cependant assez pauvre. Le documentaire (car il s’agit en soi d’un film documentaire) est projeté sans interruption pendant toute la durée du spectacle. Il faut bien attendre 20 à 30 minutes pour qu’une quelconque scénographie apparaisse : d’une projection simple, on passe d’une projection double, sur une toile de cinéma en fond de scène et une toile transparente en avant-scène qui soit redouble l’image, soit sert à des jeux de superpositions. Entre les deux, le plateau de la scène, avec une joueuse de tuba et une sorte de bureau panoptique, où deux performeurs (Yves Degryse, Fien Leysen /Sam Loncke en alternance) occupent en direct la fonction de mixage électro-accoustique, mais aussi (on y reviendra) de monteurs parallèles en montrant des images, documents et photographies, projetées sur l’écran transparent à la manière d’une diapositive qui viendrait se superposer à la projection originelle.
Ce dispositif recrée de manière artisanale, et dans un sens ludique, un montage de cinéma par des moyens scéniques. De ces effets cependant, il n'y en a pas un qui ne peut pas être reproduit par un montage cinématographique. De même lors de la représentation finale du Crépuscule des idoles : le choix de diviser l’écran en sept parties représentant les parties de l’orchestre dans leur bunker respective, bien que très réussi, ne fait que rejouer de manière légèrement plus spatialisée les propriétés du split screen1.
Une question se pose alors : si l'apport de la scène est si accessoire, pourquoi le collectif BERLIN a-t-il choisi de jouer dans une salle de théâtre plutôt que de cinéma ?
L’œuvre paraît trop bien ficelée pour supposer une erreur de jugement ou un calcul un peu cynique (le projet serait plus vendable auprès d’un public de théâtre que de cinéma), bien que cette dernière hypothèse n’est pas complètement impossible. Il semble plus pertinent d’aller chercher des réponses dans le propos de l’œuvre, et une scène justement pourrait nous donner un début de réponse. Lors d’une réunion où Yves Degryse apprend au reste de l’équipe les mensonges de Friedrich Mohr, la question se pose de continuer le projet – déjà trop avancé pour faire marche arrière – quitte à mentir, ce à quoi l’un des membres répond que ça ne change selon lui pas grand-chose, qu’on ne va pas au théâtre pour entendre des histoires vraies.
De là, on pourrait considérer que le choix d’une représentation scénique n’est pas tant prétexte à une exploration plastique du format mais plutôt à une mise à distance symbolique. Le fait de recréer en direct un montage cinématographique serait alors moins du domaine performatif que didactique – il s’agirait d’inciter au scepticisme vis-à-vis des images, en dévoilant par leur démonstration directe leur caractère factice. Soit le processus d’une distanciation brechtienne2 vis-à-vis du format documentaire, visant à démontrer que la fabrique du réel est indissociable des procédés fictionnels.
En ce sens, le collectif BERLIN reprend à son compte la formule de Jacques Rancière selon laquelle « Il n’y a pas de réel en soi, mais des configurations de ce qui est donné comme notre réel, comme l’objet de nos perceptions, de nos pensées et de nos interventions. »3
Il reste malgré tout dommage que la scénographie n’exploite pas son dispositif au-delà des questions que sa présence soulève. En dépit d’une remise en question réussie du format documentaire, c’est sur la possibilité d’une articulation commune entre la scène et la vidéo que le bât blesse, et qui fait que The making of Berlin ressemble plus à une projection augmentée qu’à du spectacle vivant. C’est d’autant plus dommage qu’il existe des exemples d’un mariage heureux entre théâtre et vidéo, notamment du côté des pièces de Christiane Jatahy.
________________________________
1« Effet consistant à diviser l'écran en plusieurs parties, chacune de ces parties présentant des images différentes ». Définition reprise du cite du Ciné Club de Caen : https://www.cineclubdecaen.com/analyse/splitscreen.htm
2La distanciation est un procédé théâtral théorisé par Bertholt Brecht, dramaturge et théoricien allemand, fondateur du Berliner Ensemble. N’étant pas spécialiste de la théorique brechtienne, je reprend ici la définition et les références du CNRTL : « Fait pour un auteur, un metteur en scène, un acteur de créer une certaine distance entre le spectacle et le spectateur, afin de développer l'esprit critique de celui-ci, par le choix du sujet, par certaines techniques de mise en scène, par le jeu des acteurs (cf. Hist., spect., 1965, pp. 1053-1054 et 1343; B. Brecht, Écrits sur le théâtre, trad. de J. Tailleur, Paris, L'Arche, 1972; Encyclop. univ., 1969, p. 558; 1974, p. 553).
3Le spectateur émancipé, La Fabrique éditions, Paris, 2008, p. 83-84.

.png)

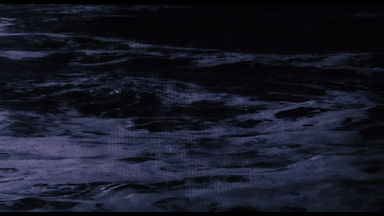

Commentaires
Enregistrer un commentaire