Au seuil
Esthétique et symbolisme dans L'Œuf de l'ange de Mamoru Oshii (1985)
L'Œuf de l'ange fait partie de ces films qui semblent davantage emprunter aux codes de la peinture qu'à ceux du cinéma, tant l'esthétique en constitue la principale grammaire. Sa narration se déploie en effet moins sous un prisme temporel (soit une série d'événements qui structurent et délimitent la durée de l’œuvre) que spatial. Le simple fait de délimiter l'espace en constitue déjà par ailleurs l'un des principaux axes structurels: du premier plan des mains au travelling final s'établit un rapport d'échelle du plus petit au plus grand. Le ton est ainsi donné : le lieu de la narration est celui d'un seuil entre deux contraires. Plus encore, la narration ne fonctionne par un système de contraires amenés à s'unifier, l'inscrivant dans un procédé de narratologie qui emprunte aux récits mythologiques : la représentation d'un monde dans une totalité cosmique.
Nous suivons les errances et allers-retours d'une jeune fille portant un œuf sous sa robe, ensuite rejointe par un homme mystérieux, tenant en permanence un objet à l'apparence hybride : une croix qui ressemble quelque peu à une arme. D'eux on ne sait pas grand-chose, et le peu de paroles qu'ils s'adressent ne révèlent rien de leur identité ou d'un quelconque passé. « Qui est-tu ? » se demandent-ils d'ailleurs l'un à l'autre sans réponse, comme pour signifier qu'il est autant impossible de (re)connaître l'autre que soi-même. Il ne nous est donné de voir d'eux presque que la façon dont ils se meuvent, traversent les espaces, réagissent aux événements extérieurs[1]. Il n'y a rien chez eux qui indique une profondeur, une vie hors du temps de la fiction ou de l'immédiat de leur actions, si ce n'est – à peine – un début de motif pour la jeune fille au mitan de l’œuvre.
Une majeure partie du temps, les raccords d'un plan à un autre correspond au passage des personnages d'un cadre à un autre. Cadre du plan, tout autant que cadre dans le plan : on les voit derrière des fenêtres, entre des ombres, eux-même silhouettes, ou encore dans les reflets de l'eau. Il ne s'agit cependant pas ici de figurer un rapport dichotomique entre la fixité des décors et la mobilité des personnage. Car l'espace lui aussi est en mouvement ; d'abord d'une rigidité quasi cadavérique, ses ombres et ses statues s'animent, et se retrouve progressivement inondé, le tout figurant un mouvement organique à la matière inanimée[2]. Inversement, le personnage de la fille semble être condamnée à une ultime immobilité. Son corps, vers la fin, se laisse gagner par le sommeil ; son ultime course aboutit par sa noyade, et sa dernière apparition est celle d'une statue. Ce que le mouvement figure est non seulement une réunion des contraires comme statué plus haut (animé/inanimé, mort/naissance, organique/minéral, etc.), mais plus précisément une réversibilité de ces contraires donnée comme destin cyclique[3].
Car L'Œuf de l'ange est une œuvre circulaire, quasi close. En parlant plus haut de peinture, je ne suggérait pas tant que le film est une succession de plans composés comme des tableaux (bien que ce soit partiellement le cas), mais plutôt que l'ensemble de ses éléments tendent à converger dans une forme d'unité cosmologique, faisant de chaque plan comme les différentes parties d'un unique tableau.
C'est en ce sens qu'il faudrait selon-moi envisager l’œuvre dans une forme de continuité tardive du courant symboliste. Bien que l'utilisation des symboles n'est pas inédite au cinéma, sans doute peu de films peuvent pourtant se revendiquer du symbolisme en tant que genre au même titre que le fantastique ou la fantasy. Et ces mêmes symboles servent le plus souvent à une figuration allégorique ou onirique du réel (ou du moins du « réel » de la fiction), rarement comme un système d'éléments interconnectés dans une totalité cosmique permettant à l'immatériel de s'incarner, autrement dit, de chercher une « représentation de la vie humaine en relation avec le cosmos » (Rodolphe Rapetti, Le Symbolisme, 2016, ed. Flammarion, col. Champs arts, p.11).
Cela vaut aussi pour l'animation, sans doute plus propice à figurer des métamorphoses de la matière, a priori impossibles pour des prises de vues réelles. Mais dans un format dont l'une des spécificités est une expansion des possibles de la figuration, Oshii opère une forme de retour arrière. Le mouvement de l'animation semble ici employé à une continuation du mouvement de la peinture symboliste, les personnages ne pouvant jamais s'extraire de leur environnement au point de devoir fusionner avec lui dans une forme d'union cosmique. Et l'agent de cette union, mêlant mort et (re)naissance, est l'eau.
Le dernier plan, tout énigmatique qu'il soit, suggère une lecture de l'ensemble à l'aune du tableau L'Île des morts de Böcklin, avec lequel il partage une certaine similitude, tant dans l'esthétique que dans sa faculté d'envoûtement[4] et dont la « puissance de fascination » est, selon Rodolphe Rapetti, « liée à l'identification de la mort avec un retour à la paix des origines maternelles, à l'élément liquide où tout se dissout et se recompose » (ibid., p. 9-10). L'eau définit la structure du film (littéralement : une mer enclot l'univers même que celui-ci représente) mais également son mouvement, incarné par la jeune fille.
Tout en elle est relié à l'eau : ses déambulation semblent avoir pour seul but de remplir des bocaux d'eau pour les poser parmi d'innombrables autres, contres les murs et sur chaque marche des escaliers de la grotte. Ce geste répété illustre lui aussi ce passage de l'animé à l'inanimé, l'élément liquide enclos dans une fiole venant se mêler au minéral jusqu'à lui aussi s'associer au décors, comme pour former une continuité fossile. Mais la fille n'est pas réduite à ce rôle de « porteuse d'eau ». Juste avant de rejoindre l'homme, un plan la montre les pieds dans l'eau ; une onde se propageant d'elle jusqu'aux extrémités du plan. L'instant suivant montre les reflets de l'onde se répercutant sur son visage. Peu après, on la voit marchant, traversée par les ombres d'une clôture dont les barreaux courbes forment comme une onde qui se propage sur elle : ses mouvements, tout à coup, adoptent un caractère plus aquatique, de sorte que son corps semblent s'allonger et ses cheveux flotter comme pris par les flots. Ce n'est que par la suite que les ombres de la ville s'animeront, sous forme de poissons géants. Ainsi, partant d'abord d'un mouvement réciproque entre le personnage et son environnement, l'un et l'autre finissent par se mêler dans un seul flux, annonçant ainsi une mise en mouvement de l'univers lui-même.
Le mouvement, dans sa continuité liquide, représente le passage d'un état à un autre mais qui se fait sans rupture, dans un flux continu. Le changement qu'il apporte n'est jamais tout à fait autre, et ne rompt jamais l'unité de l'ensemble : la mort même n'est pas tant une rupture qu'une étape dans la révolution cosmique : s'unissant à l'eau, la jeune fille embrasse son reflet et devient celui-ci, sous sa forme adulte. Sa gestation est finie, sa mort ouvre à la renaissance du biome. Il n'y a pas de commencement ni de fin – tout est consommé, et tout est à venir. La seule permanence est celle du seuil.
_________________
[1] Si ce n'est l'univers référentiel que leur design (par le prolifique Yoshitaka Amano, notamment connu pour son travail dans la franchise des premiers Final Fantasy) évoque, de la figure christique mêlée au héros de fantasy pour l'homme, à la jeune fille, qui semble à elle seule un amas de références picturales. Des sujets féminins symboliques à pré-raphaëlites, elle a le teint livide, spectral (jusqu'à emprunter le temps d'un plan la figure de l'Ophélie de Millais), ainsi que la chevelure détachée et ébouriffée.
[2] Une des métaphore filées de l’œuvre est d'ailleurs celle du fossile, soit de l'organique devenu minéral. La grotte, dont les murs sont jonchés d'ossements, semble être elle-même la carcasse fossilisée d'un animal marin. La ville, par son architecture alambiquée et ses statues marines n'est elle-même pas sans rappeler certaines villes et ruines lovecraftiennes.
[3] Il y aurait là-dessus beaucoup à dire sur le paradoxe inhérent aux films d'animation. Par rapport à l'animation d'image originellement immobiles bien entendu, mais également la contrainte au mouvement que le processus impose, sous peine de détruire l'illusion de vie dès l'apparition d'une image fixe (limite avec laquelle Oshii flirte à plusieurs reprises dans le film – on pensera notamment à un certain plan fixe quelque peu réminiscent du Stalker de Tarkovski). On pourrait voir de ce point de vue la présence de la fille parmi les statues de l’œil mécanique comme une allusion à ce passé/devenir image de l'animation.
[4] Dans le film, cela est en grande partie dû à la lenteur du travelling arrière, accompagnant le dévoilement d'un mouvement hypnotique.
.png)
.png)

.png)

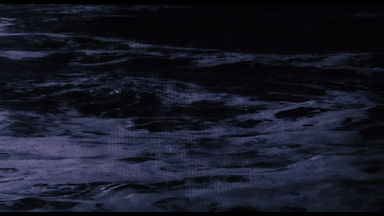

Commentaires
Enregistrer un commentaire