L'emprise
Le Silence des agneaux de Jonathan Demme (1991)
En première lecture, on peut penser que Le Silence des agneaux représente une critique de la domination masculine et de la violence qui lui est associée, autant disruptive de l’ordre établi (Hannibal, Buffalo Bill) que partie intégrante de celui-ci (le FBI, la prison, etc.). Cette violence s’incarne en premier lieu par le regard masculin porté sur la protagoniste Clarice Starling, campée par Jodie Foster. Ses différents entretiens, notamment avec son supérieur, le gardien de prison et surtout Hannibal, sont systématiquement l’objet d’un rapport de domination, par un dispositif asymétrique de champ-contrechamp où le cadre épouse la vue subjective de Clarice : les hommes, le regard face à la caméra, prennent tout l’espace du plan. Cette colonisation de l’espace du cadre se trouve redoublée par celle de l’espace physique, comme le démontre un des premiers plans montrant Clarice dans un ascenseur bondé, occupé uniquement par des hommes. L’héroïne de fait ne cesse d’être représentée comme convoitée, exploitée et traquée, jusqu’à la confrontation finale où le tueur se trouve littéralement incarné par son regard : la vue subjective, déshumanisée, des lunettes infrarouges1.
Cependant, c’est aussi par ce regard qu’on assiste à la défaite du prédateur : mise en joue, c’est finalement Clarice qui tire ; on pourrait dire de manière littérale qu’elle tue le male gaze. La narration semble alors dessiner rétrospectivement le parcours d’une émancipation quasi-féministe de la protagoniste. Mais est-ce vraiment le cas ?
Si la grille de lecture est tentante, elle se révèle pourtant déceptive. Clarice ne sort jamais vraiment du chemin balisé par les hommes. Son parcours même est le résultat de son exploitation par son supérieur, ce dont Hannibal, objet premier de cette exploitation, n’est pas dupe (« He used you », lui dit-il). Sa remise de médaille à la fin est faite par un homme, et son émancipation ressemble plutôt à une assimilation : en tirant sur le regard qui la tient en joue, elle retourne l’arme de l’homme contre lui-même. Plutôt que de s’affranchir de la violence masculine, elle la perpétue, et sa consécration n’est possible que par une sorte d’inversion, en miroir du « travestissement » de Buffalo Bill (dont nous reviendront plus tard sur la dimension problématique).
En somme, l’œuvre peut difficilement convenir à une lecture féministe car le parcours initiatique de Clarice Starling ne figure en rien une possibilité d’émancipation ou de rupture avec l’ordre patriarcal. Au regard de ces derniers éléments on peut également se demander si la mise en scène par le réalisateur du regard masculin relève vraiment d’une critique de la domination masculine, ou s’il n’est pas plutôt le reflet d’une certaine entreprise de fétichisation.
Il est assez parlant que la postérité du film ne porte pas tant sur le parcours de son héroïne, mais plutôt sur la figure d’Hannibal Lecter (et par extension la performance virtuose d’Anthony Hopkins). Si son rôle semble relativement secondaire en regard de l’enquête, sa place dans la structure et la mise en scène est au contraire centrale, allant presque jusqu’à reléguer le personnage de Clarice au second plan. De fait, sa représentation est l’objet d’une sorte d’idéalisation morbide. Sa place celle d’un démiurge ; il semble de bout en bout tirer les ficelles, contrôler le cours du récit. Un plan parmi d’autres reflète exemplairement l’emprise qu’il exerce tant sur les personnages que le cours même du récit : à l’issue de la dernière entrevue entre Clarice et Hannibal, une contre plongée montre Clarice escortée vers la sortie, en diagonale de la cage qu’habite le détenu ; celle-ci semble être cependant mise en extension par des barbelés en avant-plan qui à la fois découpent l’espace et semblent enserrer les autres personnages comme des tentacules.
Le fait que la focale semble plus mise sur la figure du prédateur que sur celui de la proie (même potentielle) pourrait finalement indiquer que le projet de Jonathan Demme n’est pas tant une dénonciation de la domination masculine qu’une exploration plus ou moins fétichiste de ses différents modes d'incarnations. Autant dans la criminalité que dans les institutions, cette violence, jusque dans ses manifestations les plus extravagantes, demeure ordinaire.
L’ambiguïté dont fait preuve Le silence des agneaux en fait une œuvre aussi passionnante que trouble. Il est néanmoins important, même en marge, de mentionner un de ses aspects les plus néfastes qui aura été de contribuer à nourrir (parmi d’autres œuvres) un imaginaire transphobe du tueur en série indifféremment désigné comme travesti et transgenre2.
_________________________
1 Ce plan en vue subjective figure de manière assez littérale l’asymétrie du rapport de force, mais suggère également par son filtre l’accès d’une dimension autre associée à ce regard : celle où le regard de l’homme sur la femme se superpose à celle du prédateur vis à vis de sa proie.
2 Pour une vue d’ensemble plus complète et accessible sur cette question, voir les vidéos (en anglais) « JK Rowling » de Contrapoints (notamment la section de 51:36 à 57:32) ou encore « Tracing the Roots of Pop Culture Transphobia » de Lindsay Ellis (et la section dédiée au film de 22:28 à 26:45).
.png)
.png)
.png)

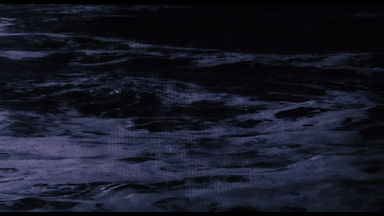

Commentaires
Enregistrer un commentaire